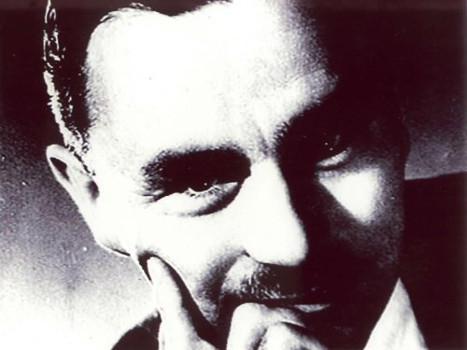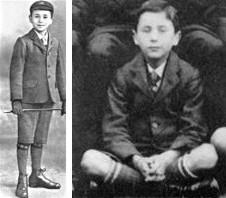« Le hasard m’avait fait revenir, par-delà des siècles de civilisation, à ces temps fabuleux où l’être puisait sa force dans le sang de l’homme. Je me découvrais de la race des vampires. »
L’Enfance de John Haigh
Né le 24 juillet 1909 à Stamford, en Angleterre, John George Haigh était le fils unique de John Robert Haigh, trente-huit ans, et Emily Hudson, quarante ans. Peu de temps après sa naissance, ses parents déménagèrent à Outwood, dans le Yorkshire, où il connut, selon ses propres aveux, une enfance sombre et solitaire. Sa famille appartenait à une communauté religieuse conservatrice et anticléricale qui prônait un mode de vie des plus austères, les Frères de Plymouth. Pour se protéger du monde extérieur, qu’il considérait comme hostile, son père avait construit une grande clôture de trois mètres de haut autour de leur propriété. Elle tenait les voisins à distance et garantissait leur tranquillité. John n’avait pas l’impression d’habiter une maison mais un monastère, étrangement calme et silencieux.
Ses parents étaient doux et aimants, mais sa vie n’était qu’interdits. Il n’avait pas le droit de faire du sport, d’aller jouer dehors, et ses rares amis ne pouvaient pas rentrer chez lui. Il n’avait que très peu de distractions. Il passait beaucoup de temps enfermé à lire la Bible, le seul livre autorisé dans la maison, ou à jouer du piano, qu’il apprenait seul. Il était un garçon calme et sensible, qui supportait mal la souffrance des autres. Il aimait les animaux, surtout les chiens, et il donnait parfois son propre repas à celui de ses voisins. S’il manifestait le désir d’aller quelque part ou de rencontrer quelqu’un, alors son père le sermonnait en soulignant la peine qu’il infligeait au Seigneur ou en le menaçant d’attirer la colère divine. Son père était un homme très droit, mais il estimait que connaître le bonheur dans un monde corrompu par le démon était un péché. Il priait le Seigneur de l’emporter au Paradis, et il demandait à ce que son corps soit rongé par les vers. Ces paroles perturbaient John, qui était alors très jeune, et il méditait souvent sur leur sens.
Un jour, son père lui expliqua que la marque bleutée qu’il portait sur le front était la conséquence de ses erreurs de jeunesse. « C’est la marque de Satan, » lui dit-il d’une voix grave. « J’ai péché, et Satan m’a marqué de son signe. Si tu commets le moindre péché, tu seras marqué toi-aussi, pour toujours, et le malheur sera sur toi. » John lui fit alors remarquer que sa mère ne présentait pas une telle marque, et son père lui répondit : « Non, car elle est un ange. » Ces paroles le terrifièrent.
Tous les soirs, il s’allongeait sur son lit, et il se demandait s’il avait fait quelque chose de mal dans la journée. Quand il avait un doute, alors il passait sa main sur son visage pour s’assurer que la marque du Diable n’était pas apparue sur son front. Il n’arrivait pas à s’endormir sans en avoir la certitude absolue. Pendant longtemps, il crut vraiment qu’il était le fils d’un pécheur et d’un ange, puis il finit par en parler à ses camarades de classes, et ils traitèrent son histoire avec le grand des mépris. John comprit alors qu’il n’était pas la merveilleuse personne qu’il pensait être, mais un enfant ordinaire. Jamais il ne parvint à oublier les mots de son père. Des années plus tard, alors qu’il savait pertinemment que ses parents lui avaient menti et que son père avait été blessé par un morceau de charbon, il continuait toujours à chercher la marque de Satan sur son front.
Parfois, John allait voir sa tante. Elle lui laissait lire la bande-dessinée qui se trouvait dans le journal, et ces moments étaient pour lui des instants de pur délice. Ses parents refusaient d’acheter le journal ou tout autre magazine, estimant « n’avoir jamais assez de temps pour lire la Bible. » Il aimait aussi les romans proposés à l’école, et L’île au Trésor l’enchanta plus que les autres encore. Malheureusement, son enthousiasme fut rapidement réfréné par son père, qui trouvait que le roman de Robert Louis Stevenson n’était pas destiné aux enfants, et qui s’en plaignit à son instituteur. John protesta vigoureusement, soulignant que les histoires de l’Ancien Testament étaient bien plus terribles que les aventures de Jim Hawkins, mais son père lui répondit que tout ce qui parlait de Dieu était à considérer différemment, clôturant ainsi le sujet et le plongeant dans une profonde insatisfaction.
À l’âge de dix ans, il rejoignit la chorale de Wakefield. Le dimanche matin, il se levait à cinq heures du matin et il parcourait à pied les cinq kilomètres qui le séparaient de la cathédrale. Il restait là-bas toute la journée. Il assistait aux offices du matin, de l’après-midi et du soir, puis il rejoignait sa maison pour les dernières prières avant d’aller se coucher. D’après son père : « John a été élevé dans une stricte atmosphère religieuse, mais il l’acceptait avec délice. Il adorait faire partie du peuple de Dieu. » Peu de temps après, il commença à prendre des cours de piano et d’orgue.
À l’école, il n’était pas très populaire. Les garçons le surnommaient « Le Chinetoque » parce qu’il avait les yeux bridés et qu’il révélait rarement ce qu’il pensait. Il ne jouait jamais avec eux dans la cour de récréation. Ses plus grandes joies lui venaient de la musique. Un jour, après avoir vu ses camarades s’amuser avec une radio portative dans la cour de récréation, il en demanda une à ses parents. Son père lui expliqua que l’objet était un instrument du diable, un signe des temps, et qu’un jour, l’anti-christ s’en servirait pour parler au monde et organiser l’insurrection contre Dieu et ses Saints. John pouvait se montrer charmant, mais s’il était pris au dépourvu, son visage juvénile se transformait en celui d’un homme extraordinairement âgé et rusé.
D’une étrange manière, il éprouvait une fascination morbide pour le sang, dont il aimait le goût. Cette passion lui était venue à l’âge de six ans, après s’être blessé à la main et avoir léché la plaie. Quand il entendait parler d’un accident de chemin de fer, il imaginait le sang s’écoulant des blessés. Dans la Bible, ses histoires préférées parlaient toutes de sacrifices. Il était fasciné par la Crucifixion. Parfois, il voyait du sang dégouliner du grand crucifix qui trônait au-dessus de l’autel dans la cathédrale, et cette vision le poursuivait jusqu’à chez lui. La nuit, il faisait des rêves gothiques, où des arbres se transformaient en crucifix pleurant du sang.
John ne savait pas comment se comporter avec les garçons de son âge, qui se moquaient de lui. Plein d’assurance, il prenait de grands airs et semblait se penser supérieur aux autres. Ses rares amis passaient parfois le chercher pour aller à l’école, mais jamais ses parents ne leur proposaient d’entrer, même quand il était en retard. Son père pensait qu’il était un garçon irréprochable, mais il se trompait. John s’amusait à cracher sur les gens depuis le pont supérieur du tramway, et il tyrannisait les plus faibles. Il tordait les oreilles des filles, frappait les garçons, et courait se réfugier derrière les grilles de sa maison dès que les choses tournaient mal.
Quand les sœurs Arundel, Nellie, May et Violet, passaient devant chez lui, il leur crachait dessus et il les insultait. Il agissait si bizarrement qu’il terrifiait ses victimes. « Je portais le blazer de mon école par-dessus mon bras lorsqu’il est venu derrière moi et me l’a enlevé, » rapporta un écolier de Wakefield. « Il l’a jeté sur la voie de chemin de fer, puis il m’a dit qu’un express allait arriver, qu’il me roulerait dessus et qu’il y aurait du sang partout. J’ai attrapé mon blazer et je suis rentrée à la maison en pleurant. Je n’ai rien dit à ma mère, mais le lendemain, j’ai refusé d’aller à l’école. »
Ses parents l’élevaient suivant des règles religieuses strictes mais ils considéraient l’éducation comme primordiale et ils le poussaient dans ses études. John se montrait courtois avec ses professeurs, qui le trouvaient agréable, poli et charmant. Pourtant, il n’aimait pas étudier. Si le sujet ne lui plaisait pas, il ne faisait aucun effort pour s’y intéresser. Il fréquentait activement le club de science et présentait des exposés, se montrant toujours plein d’assurance et d’une intelligence rare. Il possédait également un don certain pour le piano et quand il en jouait, son visage se métamorphosait. Il était particulièrement doué pour le classique, mais parfois, il se mettait à jouer une intelligible musique, et les conversations s’arrêtaient. À ce moment-là, les gens se rassemblaient autour de lui, et brusquement il sautait sur ses pieds, refermait le piano, et quittait la pièce sans dire un mot.
La Jeunesse de John Haigh
Après avoir terminé ses études, à l’âge de dix-sept ans, il commença à travailler comme apprenti dans une entreprise de motoristes. Ses collègues le trouvaient étrange, secret, et personne ne le connaissait vraiment. Il ne parlait jamais de lui, de sa famille, ou de sa vie sociale, juste de sa passion pour les voitures. Il n’arrivait pas toujours à l’heure, mais il possédait un excellent sens de l’humour et son charme jouait en sa faveur. John, qui trouvait le travail trop salissant, l’abandonna au bout d’un an. Après un bref passage au sein de la communauté éducative de Wakefield, il devint souscripteur pour les assurances, et il découvrit le monde de la haute finance. Il parvint alors à s’acheter sa première voiture, une Alfa Romeo rouge vif.
Peu de temps après, il fut soupçonné d’avoir pioché dans la caisse et licencié. Il avait eu de nombreuses aventures sans lendemain, mais à l’âge de vingt-six ans, le sexe devint pour lui un objet de dégoût. Il commença alors à développer une phobie pour les maladies, et plus particulièrement pour les infections sexuellement transmissibles. Il se lavait constamment les mains, et il portait des gants en permanence.
En 1933, il fut engagé par une société qui vendait des assurances automobiles dans les villes de Leed et de Wakefield. Toujours habillé de noir, il était d’une rare élégance et tout le monde le trouvait charmant. Il n’était pas très sociable, il ne rejoignait jamais ses collègues pour les repas, mais il était un excellent vendeur, et il gagnait plus que les autres.
Au cours de cette période, il s’acheta trois voitures. Il les dissimulait dans son garage et ne les sortait que rarement. Il prétendait ne pas avoir besoin d’argent et travailler pour le plaisir, mais la réalité était tout autre. Comme son modeste salaire ne lui permettait pas de combler ses passions, il s’était lancé dans une nouvelle carrière bien plus lucrative, celle d’escroc.
En 1934, John cessa de fréquenter l’église de ses parents. Le 6 juillet, il épousa Beatrice Hamer, une ancienne mannequin qui travaillait comme serveuse. Elle avait vingt et un an, elle était indépendante et plein d’entrain. Impressionnée par ses manières et par son charme, elle lui avait immédiatement dit oui quand il lui avait demandé sa main. Pourtant, elle avait des doutes. À un client de l’hôtel où elle séjournait, elle avoua : « Oh mon Dieu, j’aimerais que ce soit quelqu’un d’autre ! » En fait, elle le connaissait à peine. Ils gardèrent leurs noces secrètes, et personne ne fut invité au mariage. Deux mois plus tard, trois policiers se présentèrent à leur porte, et ils demandèrent à John de les suivre.
— Mais qu’est-ce que tu as fait ? lui demanda sa femme d’une voix affolée.
— Oh, ne t’en fais pas, chérie. J’ai seulement désobéi au onzième commandent, lui répondit-il en riant de ce rire sinistre qu’il avait parfois.
John, qui aimait l’argent facile, ne s’était pas posé la question de la légalité de son entreprise. « Quand j’ai découvert qu’il y avait des moyens plus faciles de gagner sa vie que de travailler de longues heures dans un bureau, je ne me suis pas demandé si c’était bien ou mal. Cela me semblait hors de propos. Je me suis contenté de dire : « C’est ce que je veux faire. » Et comme j’en avais les moyens, j’ai décidé de le faire. »
Utilisant de faux noms, il avait monté une petite escroquerie avec deux complices. Il vendait des voitures qui ne lui appartenaient pas. Malheureusement pour lui, l’un de ses clients s’était montré méfiant, et il avait alerté la police. Le 3 décembre, John, qui était considéré comme le chef de la bande, fut condamné à quinze mois de prison et seul son âge lui permit d’échapper aux assises. Peu de temps après, il écrivit une lettre à ses parents, qui était peut-être sincère, exprimant des regrets et s’excusant de la peine qu’il leur causait. Durant son séjour en prison, jamais il ne reçut de nouvelles de sa femme, ni ne s’en inquiéta.

À sa sortie, le 8 décembre 1935, il apprit qu’elle avait donné naissance à une fille, Pauline Mary Haigh, et qu’elle l’avait abandonnée pour qu’elle soit adoptée. Il n’en fut nullement affecté. Jamais il n’émit le désir de voir sa fille ou ne demanda de ses nouvelles, reniant même sa paternité. Il rencontra Beatrice une seule fois, brièvement, et il lui mentit en disant qu’ils n’avaient jamais été vraiment mariés car il avait déjà une femme à l’époque.
John se lança ensuite dans le nettoyage à sec, et son entreprise connut un grand succès. Peu de temps après, son associé mourut dans un accident de moto, et il dut liquider l’affaire pour une histoire de succession. À ce moment-là, il décida de faire le tour du monde sans escale en avion, un exploit qui n’avait jamais été réalisé, l’idée paraissait un peu folle et personne ne voulut le financer. Frustré, il se rendit à Glasgow, puis à Londres, où il s’installa. En février 1937, il postula pour un poste de secrétaire et chauffeur, et il se retrouva engagé par William McSwan, qui s’occupait de salles de jeux avec ses parents, Donald et Amy.

Les deux hommes avaient le même âge, les mêmes goûts pour les voitures rapides, les vêtements voyants et les pubs londoniens, et ils devinrent rapidement amis. Tout comme ses parents, William adorait John. Il pensait qu’il était un excellent employé, et il le promut rapidement directeur. En mai, John lui annonça son intention de partir pour se lancer dans les affaires. Il avait eu une nouvelle idée, une idée qui devait lui permettre de faire fortune mais qui le conduisit tout droit devant la cour de justice. Le 23 novembre, le juge Edward Charles le condamna à quatre ans de prison pour une escroquerie de belle envergure, déclarant que s’il n’avait pas eu vingt-huit ans, la sentence aurait été bien pire.
John n’éprouvait aucun remord. Il se voyait un peu comme un artiste, et se sentait incompris. Pour lui, briser les règles faisait partie du jeu, être sanctionné aussi, mais il regrettait de s’être fait prendre. Alors qu’il se trouvait en prison à Chelmsford, il commença à réfléchir à une nouvelle forme d’escroquerie impliquant des meurtres et des bains d’acide pour faire disparaître les corps. En automne 1940, il bénéficia d’une liberté conditionnelle, et il s’engagea comme pompier. À cette époque, les avions de la Luftwaffe bombardaient Londres, et les abominables scènes dont il fut témoin l’affectèrent terriblement. Il disait que la souffrance des victimes heurtait son âme et son esprit.
Un jour, il se blessa accidentellement à la main, et il commença à lécher le sang qui s’écoulait de la plaie, comme quand il était enfant : « Je me suis mis à lécher mon sang, et ce fut une révolution dans tout mon être. Ce liquide visqueux, chaud et sale que j’aspirais à fleur de peau, c’était la vie. La vie même ! ! Je pris alors l’habitude de me couper volontairement le doigt de la main pour avoir l’honneur et le bonheur de boire mon propre sang… »
En décembre 1941, il fut arrêté pour vol de marchandises. Il tenta de nier les faits, sans parvenir à se sauver. À ce moment-là, il se trouvait toujours en liberté conditionnelle, et le juge prononça une sentence particulièrement lourde en le condamnant à trente-deux mois de travaux forcés. Il retourna à la prison de Chelmsford pendant quelques temps, puis il fut transféré à la prison de Lincoln, où les gardes étaient autrement plus sévères et les détenus nettement moins sympathiques. Affecté à l’atelier de métallurgie, et il découvrit avec amusement qu’il pouvait facilement dérober de l’acide sulfurique sans se faire remarquer. Il commença alors à se livrer à certaines expériences. Ses camarades lui apportaient les petits rongeurs qu’ils parvenaient à capturer, et il les jetait dans un bain acide pour évaluer le temps nécessaire à la dissolution de leurs corps. Le processus était extrêmement rapide. Avec une souris, il ne fallait qu’une demi-heure. John se préparait au crime, et il ne voulait rien laisser au hasard.
L’Appel du Sang

Au terme de sa peine, en automne 1943, il s’installa à Crawley, une petite ville de sept mille habitants. Pendant quelque temps, il travailla comme secrétaire dans une firme d’ingénierie, logeant dans la maison de son employeur, Allan Stephens. M. Stephens avait deux filles, et la plus âgée, Barbara, partageait la même passion que John pour la musique. Une grande complicité naquit alors entre eux, et ils en vinrent à parler mariage. John avait vingt ans de plus qu’elle, il n’avait jamais divorcé de sa première femme, mais elle y croyait.
Au printemps 1944, il se retrouva impliqué dans un accident de voiture, et son goût pour le sang s’en trouva ravivé. « J’avais une profonde blessure à la tête, le sang coulait le long de mon visage jusque dans ma bouche. Ce goût merveilleux réveilla tout en moi, de façon définitive. Cette nuit-là, je fis un rêve horrible et terrifiant. Dans mon rêve, je voyais devant moi une forêt de crucifix qui se transformaient peu à peu en arbres. Au début, il semblait y avoir de la rosée où de la pluie qui ruisselait sur les branches, mais comme je m’approchais, je me rendis compte que c’était du sang. Tout à coup, toute la forêt commença à se tordre.
Du sang suintait des arbres, tombait des branches. Un homme allait d’arbre en arbre, recueillant le sang dans un calice. Une fois sa coupe pleine, il s’approcha de moi et me dit : « Bois. » Mais j’étais incapable de bouger. Le rêve s’estompa, mais je me sentais toujours faible et je m’étirais de toutes mes forces vers la coupe. Je me réveillais dans un état semi-comateux. Je continuais à voir ces mains qui me tendaient une tasse que je ne pouvais pas tout à fait atteindre, et cette soif terrible, inconnue de tout homme moderne, jamais ne me quitta. »
Quelques mois plus tard, lassé d’une vie trop paisible à son goût, il abandonna son travail et retourna à Londres pour se livrer à son activité favorite, l’escroquerie. Peu de temps après son arrivée, il loua un local en sous-sol au 79 Gloucester Road, et il commença à l’emménager, installant des fûts métalliques, des bonbonnes d’acide sulfurique, une pompe, divers outils et des vêtements de protection.

Un jour, alors qu’il déambulait dans les rues de la capitale, il rencontra William McSwan, qu’il n’avait pas revu depuis des années, et les deux hommes recommencèrent à se fréquenter. Le 9 septembre, ils se rendirent dans un pub londonien, The Goat, pour y boire un verre. À cette occasion, William lui expliqua qu’il avait peur d’être mobilisé et de partir à la guerre, et pris d’une inspiration subite, John lui proposa de se cacher dans son nouvel atelier.
Une fois au sous-sol, il se retrouva submergé par une incontrôlable envie de sang. Alors, sans hésiter un seul instant, il assomma son ami avec un marteau, et il lui trancha froidement la gorge. « J’ai pris une tasse et après avoir prélevé un peu de sang de son cou dans la tasse, je l’ai bu. » Il continua à boire de son sang pendant trois à cinq minutes, et il commença à se sentir mieux. Il fit ensuite glisser le corps dans une grande cuve, versa sur lui une grande quantité d’acide sulfurique, mais les vapeurs étaient telles qu’il dut se résoudre à sortir. La nuit suivante, il se retrouva submergé de rêves sanglants et surréalistes. Deux jours plus tard, il retourna à l’atelier pour vérifier l’avancée des opérations, et il ne découvrit qu’un tas de boue infâme, qu’il s’empressa de faire disparaître dans les égouts. Savoir qu’il avait tué quelqu’un et que toutes les traces de son crime avaient été effacées lui donnait un sentiment d’euphorie.
Il alla ensuite trouver les parents de William, qui avaient gardé une grande tendresse pour lui, et il leur expliqua que fuyant la mobilisation, leur fils était rentré dans la clandestinité. Il maintint cette tromperie pendant des mois, en leur faisant régulièrement parvenir de fausses lettres de William. Si la réussite de son plan le réjouissait, John avait néanmoins remarqué quelques failles dans son déroulement, et il s’empressa de les corriger, achetant des masques de bricolage en étain, une pompe et une baignoire en acier.
En juin 1945, les parents de William, qui attendaient le retour de leur fils avec impatience, commencèrent à s’inquiéter. Le 2 juillet, il les attira dans son sous-sol sous un prétexte quelconque, et il mit fin à leurs tourments. Il but ensuite un peu de leur sang, avant de faire disparaître leurs corps dans un bain d’acide. Il avait été obligé de boire le sang des deux « car celui du père n’avait pas suffi à le satisfaire. » Puis, comme il n’ignorait rien de leurs affaires, il expliqua ensuite à leur propriétaire que M. et Mme McSwan étaient partis en Amérique, et que leur courrier devait lui être transmis, y compris leurs pensions.
Imitant la signature de William sur un formulaire de procuration et se servant de son nom, il réussit à encaisser les chèques qui leur étaient destinés. Il vendit également une de leur propriété, pour un montant total de six mille livres. Pendant un certain temps, il vécut de cet argent et de celui de ses diverses escroqueries, se faisant passer pour un agent de liaison chargé des brevets et installant de fausses succursales dans plusieurs villes, puis il commença à en manquer.
En automne 1947, se prétendant intéressé par la maison qu’ils avaient mise en vente, John contacta le Dr Archibald Henderson, cinquante-deux ans, et son épouse Rose, quarante-et-un ans, un couple de bourgeois qui menaient une vie mondaine. John n’acheta jamais leur propriété, mais comme ils partageaient le même goût pour la musique classique, il les fréquenta activement durant cinq mois, jouant souvent du piano pour leur être agréable et se montrant d’une grande gentillesse à leur égard. Au cours de la même période, il loua un nouveau local au numéro 2 de la rue Leopold, à Crawley. Il y déménagea tout son matériel, et se fit livrer deux grandes cuves et trois bonbonnes d’acide sulfurique. En février 1948, il visita ses nouveaux amis, et passa plusieurs jours en leur compagnie. À cette occasion, il fit de nouveaux cauchemars, et son appétit pour le sang s’en trouva réveillé.
Le 12 février, John, qui se faisait alors passer pour un ingénieur, proposa au Dr Henderson de lui montrer sa nouvelle invention dans son atelier. Une fois sur place, il sortit le pistolet qu’il avait volé dans sa maison, et il lui tira une balle en pleine tête. Il courut ensuite prévenir Rose que son mari se sentait mal. Elle le suivit innocemment jusqu’à l’entrepôt, et il la tua de la même manière. Après avoir bu un peu de leur sang à tous les deux, il plongea leurs corps dans l’acide, mais cette fois, le liquide laissa un pied intact, celui de M. Henderson. Loin de s’en soucier, il vida tous les restes, y compris le pied, dans le coin de sa cour. Il voulait dissimuler leur disparition le plus longtemps possible pour avoir le temps de s’emparer de leurs richesses. Il écrivit un certain nombre de lettres signées du nom de Rose à leurs proches, dont une à son frère, M. Burlin. Finalement, il tira huit mille livres de la vente de leurs biens. D’une abominable manière, il offrit quelques-uns des vêtements de Rose à sa bien-aimée Barbara, qui était toujours amoureuse de lui. À un certain moment il frôla la catastrophe, quand M. Burlin, se montrant suspicieux, le menaça d’aller trouver la police. John réussit alors à le convaincre que le couple s’était enfui en Afrique du Sud, suite à un avortement illégal pratiqué par le Dr Henderson.
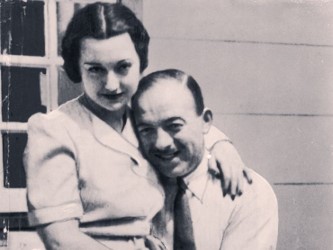
En juin 1948, John prétendit que sa voiture, une Lagonda, avait été volée. Peu de temps après, elle fut retrouvée écrasée au pied d’une falaise. Quelques semaines plus tard, un corps non identifié fut découvert à proximité, mais la police en conclut que les deux incidents n’étaient pas liés. John n’était peut-être pas responsable du meurtre, mais sa voiture n’avait pas été volée. Il avait parlé de ses projets à Barbara. Il l’avait amenée sur la falaise, et il lui avait expliqué qu’il voulait toucher l’argent de l’assurance.
Troublée, elle commença à se méfier de lui. Peu de temps après, alors qu’il lisait un journal local, il remarqua l’avis de décès de l’un de ses camarades d’école. Il écrivit alors un mot à sa mère, l’assurant de sa sympathie et demandant l’autorisation de venir la voir. La pauvre femme, qui était déjà veuve, en fut profondément touchée. Il pensait avoir trouvé sa prochaine victime, mais elle déjoua ses plans en mourant subitement. Depuis son retour à Londres, il fréquentait des hôtels haut de gamme. Son mode de vie, son amour du jeu et ses goûts de luxe lui coûtaient une fortune, et il était souvent endetté. Il jonglait entre ses créanciers, et il cherchait sans cesse de nouvelles sources de revenus.
Durant cette période, il essaya d’attirer plusieurs de ses connaissances dans son atelier, sans y parvenir. Peu de temps après, le frère de Rose Henderson le contacta une nouvelle fois. Il lui expliqua que leur mère était gravement malade, que sa sœur devait être prévenue, et il lui demanda de l’accompagner à Scotland Yard pour signaler sa disparition. John accepta immédiatement, et il lui proposa de l’héberger gracieusement lors de son séjour à Londres.
Le 18 février 1949, il invita Mme Olive Durand-Deacon, une veuve d’un certain âge qui fréquentait le même hôtel que lui, à venir étudier un projet de faux ongles dans ses locaux de la rue Leopold. Elle fouillait dans son sac, cherchant des papiers, quand il lui tira une balle dans la nuque. Après avoir incisé sa gorge avec un canif, il versa son sang dans un petit verre, et le but tranquillement. Une fois ses besoins assouvis, il la dépouilla de ses biens, puis il glissa péniblement son corps dans la cuve d’acide, elle faisait bien dans les quatre-vingt-dix kilos, et brusquement épuisé, il sortit prendre le thé.

Le lendemain, John, qui se pensait invulnérable, mit les bijoux de sa victime en gage et il envoya son manteau tâché de sang au nettoyage. Deux jours plus tard, une amie de Mme Durand-Deacon, Constance Lane, commença à s’inquiéter de sa disparition. « Vous ne savez pas où elle se trouve ? Elle m’avait dit que vous deviez l’emmener dans votre usine ? Il faut prévenir la police ! »
John lui expliqua qu’elle n’était jamais venue au rendez-vous, et pour écarter les soupçons, il lui proposa de l’accompagner au poste de police pour signaler sa disparition. Un avis de recherche avec sa photo et sa description fut alors distribué à tous les postes de police et à la presse. John répondait volontiers aux questions des journalistes, et il montrait toujours une inquiétude affectée. Avec ses bonnes manières, son élégance, son sourire poli et ses grands yeux bleus, il charmait tout le monde.
Le sergent Alexandra Lambourne interrogea les clients et les employés de l’hôtel, où Mme Durand-Deacon séjournait depuis deux ans, et le directeur lui fit une description peu flatteuse de John Haigh, soulignant qu’il leur devait énormément d’argent. Intriguée, elle demanda à ce que ses antécédents soient vérifiés. Elle l’avait déjà questionné, et même s’il s’était montré habile dans ses réponses, elle avait trouvé bizarre qu’un homme d’âge moyen se complaise en compagnie de toutes ces vieilles dames. Une heure plus tard, Scotland Yard rapporta qu’il avait été arrêté et condamné à plusieurs reprises pour escroquerie, conspiration, falsification, obtention d’argent sous de faux prétextes et vol.
Arrestation et Condamnation

Pendant que John paradait devant les journalistes, des agents de police forçaient la porte de son atelier, au numéro 2 de la rue Leopold, à Crawley. Il se vantait d’être le directeur de la Hurstlea Products, mais bien évidemment, il mentait. En fait, il avait loué une maison en brique de deux étages entourée d’une clôture de deux mètres de haut à M. Jones, le véritable directeur de la Hurstlea Products, « pour un travail expérimental. »
L’inspecteur Pat Heslin et ses hommes fouillèrent le bâtiment, découvrant des outils, des plateaux, des fils, une feuille de papier cellophane rouge et un tampon de coton près d’un banc. Trois bonbonnes étaient emballées dans de la paille, non loin d’une pompe. Une était vide, les autres à moitié pleines. Un tablier en caoutchouc auréolé de produits chimiques pendait à un crochet de porte, près de bottes et de gants en caoutchouc, et un masque à gaz traînait dans une besace de l’armée. Une boîte à chapeau et une mallette portant les initiales « HGJ » furent également saisies. À l’intérieur, se trouvaient des papiers, un certificat de mariage, plusieurs passeports, des cartes d’identité, et des permis de conduire, et un ticket de nettoyage à sec pour un manteau d’astrakan. Un revolver de calibre 38 ayant récemment servi et huit cartouches de munitions étaient dissimulés au fond de la boîte à chapeau.

Après avoir lu un article dans la presse, M. Bull, de Horsham, contacta la police pour signaler qu’un homme était passé mettre des bijoux en gage le lendemain de la disparition de Mme Durand-Deacon. L’inspecteur Symes passa chercher les bijoux, qui furent identifiés comme lui appartenant. Ils avaient été déposés à la boutique par un certain M. McLean, mais l’assistant du bijoutier avait déjà vu cet homme auparavant, et il souvenait de son véritable nom.
John fut alors arrêté. L’inspecteur Albert Webb lui demanda de le suivre jusqu’au poste de police, et il lui répondit poliment : « Certainement. Je ferai tout pour vous aider, comme vous le savez. » Une fois arrivé, il fuma une cigarette, puis il lut le journal et s’endormit. Il ne semblait pas inquiet, mais indifférent. L’interrogatoire débuta trois heures plus tard. Au début, il refusa de répondre aux questions concernant la disparition de Mme Durant-Deacon : « Si je vous disais la vérité, vous ne me croiriez pas. C’est bien trop fantastique pour être cru, » dit-il en riant. Puis il comprit que la police avait des preuves contre lui, et il finit par avouer.
« Je vais tout vous dire. Mme Durand-Deacon n’existe plus. Elle a complètement disparu et aucune trace d’elle ne pourra jamais être retrouvée. Je l’ai détruite avec de l’acide. Vous trouverez de la boue rue Leopold, et c’est tout ce qu’il en reste. Toute trace a disparu. Après l’avoir entraînée dans l’entrepôt de la rue Leopold, je lui ai tiré une balle dans la tête, par derrière, alors qu’elle était en train d’examiner des papiers qui devaient servir pour ses faux ongles. Ensuite, je suis allé à la voiture, j’ai pris un verre et un canif, et j’ai pratiqué une incision sur le côté de sa gorge. J’ai recueilli son sang dans le verre, puis je l’ai bu. Au moyen d’une pompe à main portative, j’ai prélevé de l’acide sulfurique dans une bonbonne pour en remplir le fût, et j’ai laissé la réaction s’opérer… Je dois vous signaler qu’entre le moment où je l’ai mise dans le fût et celui où j’ai versé l’acide, je suis allé à l’Ancien Priors pour y boire une tasse de thé… Le lundi, je suis retourné à Drawley, pour y trouver le processus presque achevé. Seuls un morceau de graisse et un fragment d’os flottaient encore. J’ai vidé la boue avec un seau, puis je l’ai versé sur le sol en face de l’atelier, afin de pouvoir rajouter de l’acide dans le fût pour décomposer le reste… Le mardi, je suis retourné à Crawley : la décomposition était totale. »
Une fois sa confession terminée, il interpella les enquêteurs, leur demandant avec arrogance comment ils pensaient prouver l’assassinat sans le corps. John avait lu un article qui parlait du « corpus delicti, » un terme qui qualifie l’essence même du crime, et comme il ne connaissait guère le latin et encore moins le droit, il en avait conclu qu’en l’absence de cadavre, un meurtrier ne pouvait être condamné.
Le chef de la police du Sussex de l’Ouest demanda de l’aide à Scotland Yard, qui lui envoya le Dr Simpson et l’inspecteur Symes en renfort. Keith Simpson, médecin légiste, inspecta le tas de boue dans la cour de l’atelier de John Haigh, découvrant douze kilos de graisse humaine, trois calculs biliaires, une partie de pied gauche, dix-huit fragments d’os humains, des prothèses dentaires intactes, une poignée de sac à main en plastique rouge et un tube de rouge à lèvre. Du sang fut prélevé sur les murs, le même que celui qui tâchait le manteau d’astrakan et la manche de l’une des chemises du suspect.

Accusé du meurtre de Mme Durand-Deacon, John fut placé en détention provisoire à la prison de Lewes. Il se vanta ensuite d’avoir tué William, Donald et Amy McSwan, Archibald et Rose Henderson, mais également un certain Max, de Kensington, une jeune fille nommée Mary originaire d’Eastbourne, et une femme d’âge moyen d’Hammersmith. Il décrivit soigneusement tous les crimes, soulignant avoir bu un verre de sang de chacune de ses victimes parce qu’il en avait un « besoin urgent, » mais aucune des trois dernières ne put être identifiée, et la police supposa qu’il les avait inventées.
Le 3 mars, ignorant la loi interdisant de donner des détails sur une affaire en cours pour ne pas influencer l’opinion publique, le Daily Mirror publia un long article sur les « horribles meurtres du vampire, » sans citer de nom. Trois semaines plus tard, le journal fut reconnu coupable d’outrage au tribunal pour avoir explicitement dépeint le tueur comme un vampire, et condamné à dix mille livres d’amende. Son rédacteur en chef, Silvester Bolam, écopa de rois mois de prison.
Le 1 er avril, le procureur E.G. Robey ouvrit le dossier de l’accusation devant dix magistrats du Sussex. John semblait confiant. Il admit la plupart de ses crimes, et plaisanta tout au long de la procédure. En raison de ses déclarations étranges, la question de son état mental vint à se poser. Il prétendait avoir vu le sang de ses victimes pour se régénérer, et comme aucun cas semblable n’avait jamais été répertorié, les experts n’y croyaient pas.
De nombreux médecins et psychiatres vinrent l’examiner, et ils en arrivèrent à la même conclusion. John était parfaitement conscient de ses crimes, qu’il avait minutieusement planifiés. Ils pensaient qu’il simulait la folie, qu’il avait inventé ses cauchemars, et son obsession pour le sang. Seul le Dr Henry Yellowlees lui diagnostiqua une personnalité paranoïaque égocentrique. Âgé de soixante-et-un ans, le Dr Yellowlees était diplômé en psychologique. Pendant la guerre, il avait été psychiatre consultant auprès du Corps expéditionnaire britannique en France. Il avait également été examinateur en maladies mentales pour l’Université de Londres.
Il expliqua que John avait été élevé dans une religion fanatique par une mère qui accordait beaucoup de crédibilité aux rêves comme outils de divination, qu’il cauchemardait fréquemment de crucifix dégoulinants de sang, et qu’il s’était créé une vie mystique personnelle « qu’il chérissait car elle était séparée du monde cruel. » Il pensait qu’en cherchant à s’échapper de l’univers étouffant de ses parents, les lignes de démarcation entre la réalité et son imaginaire s’étaient estompées. Un sentiment de toute-puissance l’avait alors envahi, et il avait commencé à une double vie. Il croyait qu’en tuant ces gens, il accomplissait sa destinée. Il savait que ce qu’il faisait était condamnable, mais il s’estimait au-dessus des lois.
Le Dr Yellowlees rapporta également qu’il lui avait confié avoir bu sa propre urine à plusieurs reprises après avoir lu un verset de l’Ancien Testament, qu’il se pensait très intelligent, et qu’il n’était pas intéressé par le sexe car son instinct était sublimé par l’adoration qu’il se portait. « D’après mon expérience, l’insensibilité absolue, la gaîté, et l’indifférence presque amicale de l’accusé pour les crimes qu’il a librement admis avoir commis en font un cas unique. »
La jeune Barbara Stephens était bouleversée. Elle lui rendit visite en prison, s’attendant à le trouver brisé par le poids de fausses accusations, et elle le découvrit euphorique. Non seulement il admettait tous les faits qui lui étaient reprochés, mais il semblait se flatter de toute l’attention qui lui était accordée. En lisant les journaux, elle avait réalisé que toutes ses victimes, ou presque, étaient de ses amis. Il lui avait avoué son amour la semaine où il avait tué William, et deux jours après l’assassinat de Donald et Amy McSwan, ils avaient passé une merveilleuse journée ensemble. Il lui avait parlé mariage juste après avoir tué d’Archibald et Rose Henderson, et il lui avait même en lui offert une robe de la défunte.
Le lendemain de la mort d’Olive Durand-Deacon, ils s’étaient retrouvés pour prendre le thé. Tourmentée par le doute, elle lui demanda s’il avait déjà pensé à la tuer, et il parut surpris de sa question. Il lui assura qu’une telle idée ne lui était jamais venue à l’esprit, et que jamais il n’aurait touché un cheveu de sa tête. Barbara ne savait rien de l’homme qu’elle rêvait d’épouser, mais elle continuait à l’aimer. Elle lui écrivit des lettres et lui rendit visite en prison jusqu’à la fin de sa vie. Pour son quarantième anniversaire, elle lui envoya un porte-bonheur. Pourtant, elle n’était pas totalement inconsciente. Elle savait qu’il l’aurait tuée aussi, si cela s’était avéré nécessaire.
Présidé par le juge Humphries, le procès de John Haigh s’ouvrit le 18 juillet 1949. Quatre mille personnes attendaient devant le tribunal dans l’espoir d’obtenir un siège, et les déçus furent nombreux. Quelques privilégiés tentèrent de vendre leur place, mais les policiers qui gardaient la salle d’audience s’en aperçurent, et ils mirent fin à l’histoire. Comme John n’avait pas les moyens d’engager un avocat pour assurer sa défense, Stafford Somerfield, journaliste, avait passé un accord avec lui. The News of the World acceptait de payer son avocat s’il leur fournissait en exclusivité l’histoire de sa vie. John, qui aimait parler de lui-même, avait aussitôt commencé à écrire. Il plaida non-coupable, et personne ne souleva la question de ses facultés mentales.
Pour l’accusation, l’affaire était simple. John Haigh avait prémédité tous ses crimes dans le but de voler les biens de ses victimes, et trente-trois témoins furent appelés à la barre pour tenter de le prouver. L’avocat de la défense souligna le comportement aberrant de son client, qu’il décrivit comme malade mentalement, et il fit appeler le Dr Yellowlees, le seul témoin de la défense. Le psychiatre rapporta ses entretiens avec l’accusé, comparant ses différents symptômes avec ceux de la paranoïa, sans parvenir à convaincre les membres du jury. Pendant ce temps, John souriait et faisait des mots-croisés, indifférent à son sort. Il ne prêta aucune attention à la procédure jusqu’au discours de clôture du juge, qu’il qualifia de chef-d’œuvre. Il fallut seulement quinze minutes au jury pour décider de sa culpabilité. Le juge lui demanda s’il avait quelque chose à rajouter, et il répondit : « Non, rien du tout. » Le lendemain, il annonça son intention de ne pas faire appel de la sentence.
Après le procès, deux médecins et trois éminents psychiatres vinrent l’examiner à la prison de Wandsworth, et ils en arrivèrent aux mêmes conclusions : aucune maladie mentale n’entravait son jugement. John, qui attendait l’exécution de la sentence, rédigea l’histoire de sa vie, comme il l’avait promis. Il écrivit également au Dr Yellowlees pour le remercier, soulignant que tout au long de l’histoire les grands hommes, Confucius, Hitler, Jésus Christ, Jules César, Napoléon, avaient été considérés bizarres. Il envoya quelques lettres à sa bien-aimée Barbara, lui confiant son espoir de la retrouver au ciel. Ses propres parents, qui étaient déjà âgés, ne firent pas le déplacement pour venir le voir, mais sa mère envoya un journaliste en prison pour lui parler en son nom.
Le Musée de Madame Tussaud lui demanda la permission de faire un masque de mort de son visage, ce à quoi il consentit. Il ne craignait pas d’être pendu. Alors qu’il attendait la mort dans sa cellule, il écrivit à sa mère : « Mon esprit restera attaché à la terre pendant un certain temps. Ma mission n’est pas encore accomplie. »
Il mourut le 6 août 1949, le sourire aux lèvres. Il légua ses vêtements au Musée de Madame Tussaud, où une statue de cire le représentant avait été érigée. De son vivant, il s’était toujours montré d’une grande maniaquerie vestimentaire. Avant de mourir, il avait demandé à ce que son apparence soit toujours impeccable, ses pantalons plissés, ses cheveux bien coiffés, et le bout de ses manches de chemise apparentes.
« J’ai été poussé à tuer par de sauvages démons sanguinaires. L’esprit qui se trouvait à l’intérieur de moi m’ordonnait de tuer. »
Sources: John George Haigh, the Acid-Bath Murderer: A Portrait of a Serial Killer and His Victims de Jonathan Oates, et Clinical Vampirism: A presentation of 3 cases and a re-evaluation of Haigh, the acid-bath murderer, de R. E Hemphill et T. Zabow.